Sofia Coppola se love dans son habituel style cotonneux pour raconter la vie de l'épouse du King, mais échoue à nous impliquer émotionnellement.
Vous reprendrez bien une tranche d'Elvis Presley ? Un an après Elvis, biopic über-flashy du roi du rock'n roll, voici Priscilla, par Sofia Coppola. Une sorte de réponse au féminin et en sourdine à la fresque tapageuse de Baz Luhrmann ; un portrait de Priscilla Presley au temps où elle vivait auprès du King dans la légendaire demeure de Graceland, adapté du livre de souvenirs Elvis et moi, que l'intéressée a publié dans les années 80. Pour Sofia Coppola (qui a appris l'existence du Elvis de Luhrmann alors qu'elle était déjà en train de développer son propre film), c'est un projet évident, presque caricatural : un nouveau portrait spleenétique d'une princesse teenage prisonnière de son royaume, l'étude cotonneuse et alanguie de la Marie-Antoinette du Tennessee.
Teenage ? C'est le mot, oui, puisque Priscilla n'avait que 14 ans lorsqu'elle commença à être courtisée par Elvis, qui en avait dix de plus. Le film n'élude pas du tout cette différence d'âge choquante (aujourd'hui comme hier), au contraire, tout part de là : de l'observation minutieuse et troublante que fait Sofia Coppola, dans les premiers moments du film, du pas de deux qui se joue entre eux : elle (Cailee Spaeny), la fan d'Elvis, n'en revient pas que l'idole pose les yeux sur elle, et lui (Jacob Elordi), macho immature, veut enfermer cette fille dans une cage dorée, comme un symbole de pureté et d'innocence au milieu du tourbillon délirant qu'est sa vie. Victime (du colonel Parker) dans le film de Baz Luhrmann, Elvis révèle ici sa face prédatrice.
L'un des aspects les plus frappants (et réussis) de Priscilla est la façon dont il tient le plus possible à distance les hauts faits d'armes de Presley, les images de la légende, tous les passages iconographiques obligés, pour procéder à une forme de démythification qui passe par le décadrage et la soustraction. C'est Graceland sans Elvis, et sans sa musique (les gérants du catalogue n'ont pas autorisé Coppola à utiliser les chansons). Comme le Roi n'est pas là les trois quarts du temps (il tourne des films, s'éclate avec ses potes), Priscilla poireaute, s'ennuie, espère, se demande ce qu'il attend d'elle, si elle est captive ou, au contraire, plus libre que toutes les jeunes filles d'Amérique, qui rêveraient d'être à sa place.
Cette routine triste des princesses pop qui n'ont rien d'autre à faire que d'attendre la fin du jour en arpentant d'épaisses moquettes les pieds nus, Sofia Coppola la retranscrit très bien. Mais le film achoppe quand il s'agit, dans son dernier mouvement, de raconter l'émancipation de son héroïne, une libération qui agirait comme une allégorie de l'essor du féminisme dans les années 60 et 70, vu à travers le miroir grossissant – et un peu déformant – de Graceland. L'extrême modestie du dispositif (dramaturgie en sourdine, seconds rôles à peine esquissés, prestation excessivement effacée de Cailee Spaeny…) empêche notre implication émotionnelle. A la fin, la cage s'ouvre, la bulle éclate, mais l'empreinte que le film pourrait laisser en nous semble s'effacer presque instantanément.
Priscilla, de Sofia Coppola, avec Cailee Spaeny, Jacob Elordi… Prochainement.




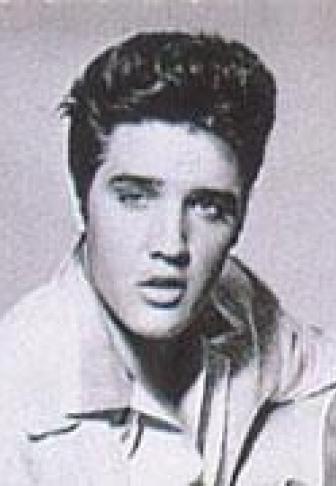










Commentaires